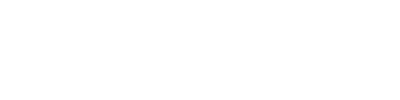Trump Président, c’est la démocratie qui prend – 27/04/2025
Ça fait deux mois que Donald Trump est de nouveau président des États-Unis depuis son investiture le 20 janvier dernier. A peine de retour à la Maison Blanche, il s’est empressé de concrétiser un bon nombre de ses promesses de campagne. 26 décrets ont été signés dès son premier jour de mandat, un record absolu. Et le tout, devant les caméras et une foule de partisans. Depuis, c’est plus d’une centaine de mesures qui ont été actées par l’administration Trump. Parmi elles, pas moins de 80 décrets présidentiels. En comparaison, Biden en avait signé 77 dans la première année. Chez MOB, on a voulu vous montrer à quel point ça peut aller vite de s’attaquer aux piliers de la démocratie.
Première étape : affaiblir la bureaucratie et les services publics
Au début de son mandat, Donald Trump a créé le DOGE (le département de l’Efficacité gouvernementale), dirigé par Elon Musk. L’objectif de ce département est de réduire les dépenses fédérales, notamment en supprimant des postes de fonctionnaires et des programmes. Ce fut le cas avec les projets Diversité, équité et inclusion. Tout ce qui n’est pas jugé utile est supprimé. Ce sont 1 300 employés renvoyés du ministère de l’éducation avec, en arrière plan, la volonté de supprimer complètement le ministère. Au-delà du projet en lui-même, un autre problème se pose. Elon Musk joue un rôle important dans ce démantèlement du gouvernement fédéral et continue ses activités en tant qu’entrepreneur privé. Il continue de fournir des produits et des services rémunérés à l’administration Trump. Il y a donc conflit d’intérêt comme le souligne très bien Le Monde.
Attaquer les droits humains, un classique
Dans la lignée des nombreuses mesures contre l’immigration, l’une d’elle vise à supprimer le droit du sol. Plus précisément, à lui ajouter des conditions. Le droit du sol, créé en 1868, c’est le fait que toute personne née sur le sol américain devient de facto citoyenne. Il est d’ailleurs protégé par le 14ème amendement de la Constitution américaine. Aujourd’hui, il pourrait être restreint aux enfants nés d’un parent citoyen étasunien ou détenteur d’une carte verte.
Et ce n’est pas la seule mesure qui vise à réduire les droits de certains citoyens. Donald Trump s’est aussi attaqué à la communauté LGBT+, aux femmes et aux minorités. Dès le début de sa campagne, il a affirmé que seulement deux sexes seraient reconnus dans le pays, niant la réalité des personnes trans et non-binaires. Certains américains qui ont effectué une transition de genre, ont ainsi vu la mention sur leur papiers d’identité changer, à l’image de l’actrice Hunter Schafer, qui en a fait part sur ses réseaux sociaux. Trump a également signé en janvier dernier un décret qui interdit le recrutement de personnes trans dans l’armée. Fin février, une note a été publiée, mentionnant la mise à l’écart de personnes déjà embauchées, une discrimination analysée par Libération.
Tout s’enchaîne très vite et ça ne touche pas seulement les citoyens américains. Elon Musk a annoncé la fermeture de l’USAID, l’Agence des États-Unis pour le développement international. En attendant, il a licencié une bonne partie du personnel. Les missions de cette agence ? Participer à la réduction de la pauvreté, la promotion de la démocratie, prévenir les conflits… Bref, apporter de l’aide humanitaire dans plus de 120 pays.
Claire Thoury du Mouvement associatif nous détaillait récemment l’importance de cet écosystème en France : « Sans les associations, notre société ne tiendrait pas« .
Trump avait aussi promis de sortir de certaines instances internationales. C’est maintenant chose faite, à commencer par le Conseil des droits de l’Homme, de l’ONU et l’OMS. Et puis, comme lors de son premier mandat, il retire les États-Unis des Accords de Paris, un pacte mondial de lutte contre le réchauffement climatique. Pour rappel, le pays est pourtant le deuxième plus grand pollueur, derrière la Chine. Le financement des associations est pourtant un enjeu majeur pour la démocratie.
Brider l’éducation, la science et les médias
Le nouveau gouvernement ne s’est pas arrêté là. Donald Trump s’attaque aussi à la science, à l’éducation et aux médias. Les licenciements, comme vu plus haut, ont visé particulièrement ces trois secteurs. à cela s’ajoute aussi des coupes budgétaires importantes. Du côté des médias publics, plusieurs d’entre eux, à l’image de la radio Voici of America, leurs journalistes ont reçu des mails de licenciement. Ils s’attendent même à voir leur média disparaître… Une attaque assumée de la liberté de la presse, régulièrement mise à mal face à Trump.
Du côté de la science, une censure se met également en place. Une longue liste de mots est désormais à bannir des recherches, sous peine de suppression de financements. Par exemple, « inégalité », « femme », « genre », « LGBT », « handicap », « personnes âgées », « discrimination », « inclusion », « victime », etc. Des milliers de pages web de travaux de recherches ont aussi été supprimées, dont la majorité traitaient de questions de genre ou de changement climatique. Pourquoi parle-t-on de cela ? Le propre d’une démocratie, c’est que les citoyens puissent s’informer et s’éduquer afin de prendre des décisions éclairées. Aux États-Unis, on s’éloigne donc chaque jour un peu plus de cet accès à l’information pour toutes et tous. Une suppression évidente du travail journalistique/scientifique souligne le média Usbek et Rica.
La fin des gardes fous ?
À travers toutes les mesures prises par Donald Trump, ce sont les contre-pouvoirs et notamment le pouvoir judiciaire qui sont mis à l’épreuve. Parmi les décrets signés le premier jour de son mandat, Trump a accordé une grâce totale à plus de 1 000 personnes impliquées dans l’assaut du Capitole le 6 janvier 2021. Des partisans de Trump ayant, pour la plupart, pris part à ce que l’on qualifie aujourd’hui de tentative de coup d’Etat, et qui ont été condamnés. Une façon de dire que la justice n’est pas de leur côté et qu’il s’y oppose donc.
La chambre des représentants et le Sénat étant désormais à majorité républicaine, il y a peu de chance pour qu’ils s’opposent à leur leader. La Cour suprême, la plus haute juridiction judiciaire, est également composée de 6 républicains sur 9 magistrats. Pour autant, elle s’est positionnée contre une partie des coupes budgétaires qu’Elon Musk a infligé à l’USAID, de qui l’a obligé à faire machine arrière. Elle a également rappelé à l’ordre Donald Trump, après une attaque lancée à l’encontre d’un juge fédéral. Le président avait appelé à « destituer » ce juge de Washington, James Boasberg, parce qu’il avait suspendu une expulsion de migrants.
Les juges fédéraux ont reçus de nombreux recours depuis la prise de pouvoir de Trump. Plus d’une centaine, qui viennent de citoyens, d’associations, de syndicats, d’États fédérés voire aussi de coalition d’États démocrates. Certains d’entre eux ont permis de mettre sur pause certains décrets. Par exemple, celui sur le droit du sol, considéré comme « manifestement inconstitutionnel ». Ou encore l’interdiction de personnes transgenres dans l’armée jugée « empreinte d’hostilité » et allant contre le principe d’égalité.
Trump compte bien faire appel de ces décisions, une longue bataille contre l’administration qui explique aussi ses attaques répétées à son égard. Si on résume, en deux mois, Trump s’est attaqué aux services publics, aux droits humains pour asseoir sa domination. Il a lancé une grande réforme de l’Education et une baisse drastique des financements scientifiques pour rendre les citoyens dociles et éviter toute analyse critique. Enfin, il tente d’effacer tout contre-pouvoir médiatique et judiciaire.
Le démantèlement de la démocratie, ça peut donc aller très vite, même dans des systèmes solides et bien rodés. Un signal d’alarme pour notre propre pays venu d’Outre-Atlantique.
–
Réalisation et montage : Perrine Bontemps
Sources : The Guardian, Associated Press, France 24, Libération, Le Monde