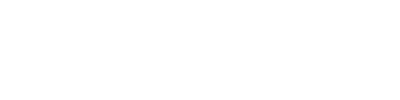FILMOCRATIE #3 : DANS LA VAGUE AUTORITAIRE – 16/06/24
Ça ne vous aura pas échappé, l’actualité politique est très chargée. Jordan Bardella est arrivé en tête des élections européennes avec 31,5% des voix, Macron a dissous l’Assemblée nationale et nous plongeons dans des élections législatives éclair. Pour ce nouvel épisode de Filmocratie, on voulait donc parler de ce qui inquiète dans le programme et les idées d’extrême-droite mais aussi dans les manœuvres macronistes. La tendance autoritaire et les dictatures. Et quoi de mieux que la fiction pour interroger le réel ?
Le cinéma raconte très bien ces dérapages de l’Histoire et participe à notre travail de mémoire. Les films sur le nazisme ne manquent pas par exemple et nous rappellent cette période sombre.
Mais les réalisateurs ne vont pas uniquement creuser dans l’Histoire pour parler de démocratie. Il vont aussi inventer des sociétés futuristes pour alarmer sur ces dangers très présents. Le cinéma projette sur grand écran, au regard de toutes et tous, les risques très actuels de l’autoritarisme. Et c’est ça qu’on voudrait creuser aujourd’hui dans Filmocratie.
Le film qui raconte vraiment à quel point il est facile de tomber dans l’autoritarisme ne se passe pas dans un parti politique, mais dans un lycée, en Allemagne. Un film qui nous montre que quand la vague monte, et qu’on s’en rend compte, il est souvent déjà trop tard.
Le film La Vague met en scène une expérience scolaire qui a dérapé, dans la classe d’un enseignant californien. A l’époque, Ron Jones veut sensibiliser les lycéens à la montée du nazisme. Et plutôt que de faire un cours classique comme ceux que vous avez dû vivre, il passe de la théorie à la pratique. Il invente un jeu de rôle de la dictature sous forme d’exercices en apparence sans danger.
Sauf que les élèves vont aller plus loin, trop loin, au point que le prof perde le contrôle et que l’histoire ne tourne au cauchemar. La rapidité et la simplicité avec laquelle ce faux parti a séduit cette classe américaine est stupéfiante. D’autant qu’à l’époque de la “vraie” vague, on est en 1967 et le spectre de la Shoah et des guerres mondiales est encore dans tous les esprits.
« – Qu’est-ce que l’autocratie ? Une idéologie ? Le contrôle ? La surveillance ? La discipline Monsieur Wenger. – Donc on ne verra jamais une nouvelle dictature ? La Vague, Dennis Gansel (2008)
Ce film raconte à merveille la force d’attraction puissante de ce type d’idéologie : le besoin d’ordre, de discipline de faire corps politiquement et socialement, de se retrouver derrière un chef et une identité commune. Mais attention, ce n’est pas sans danger.
Pas de place pour la pluralité d’opinion ou la diversité dans des sociétés autoritaires. La Vague du film emportera d’ailleurs avec elle les opposants à cette étrange expérience et il faudra un drame pour y mettre un terme. Cette expérience microscopique a eu des conséquences dramatiques dans le passé, alors ça donnerait quoi à l’échelle d’un pays dans le futur ?
Le cinéma d’anticipation ou la science-fiction nous permettent d’appréhender le pire : l’exercice du pouvoir de ces courants réactionnaires, autoritaires et oppressifs. Le principe de l’autoritarisme, quel que soit ses racines, c’est d’imposer le contrôle des populations et la violence envers les minorités ou l’opposition. Qu’elle vienne de notre planète, ou non.
Dans District 9, ce sont des extraterrestres bloqués sur Terre qui subissent l’oppression humaine. Parqués dans des camps, interdits de se mélanger, on exploite leur technologie et on les humilie. Ce film rejoue l’apartheid sudafricaine mais avec des Aliens, ces étrangers ultimes, pour critiquer le racisme. Et aujourd’hui, vu les propos xénophobes ou islamophobes distillés par certains médias et partis d’extrême droite on est certain qu’une fois au pouvoir, il en feraient de même.
Et quand ce ne sont pas les minorités racisées ou les religions qui sont attaquées, ce sont souvent les femmes qui subissent. C’est le cas dans la Servante écarlate, adaptation en série d’un roman de Margaret Artwood où les Etats-Unis ont pris un tournant autoritaire patriarchal.
« Vous servirez les leaders et leurs épouses stériles. C’est vous qui porterez leurs enfants. » La Servante écarlate, Bruce Miller (Série 2017)
Retour au foyer pour les américaines qui, en plus de perdre leur autonomie et indépendance, doivent également subir les violences sexuelles de leurs maîtres masculins pour repeupler les Etats-Unis. Et elles n’ont pas le choix, sous peine d’être exécutées.
Une société autoritaire et violente aux Etats-Unis ? Ca pouvait sembler surréaliste il y a quelques années. Mais les récentes atteintes au droit à l’IVG ou les incitations à la guerre civile du camp Trump sentent quand même un peu le roussi. N’oublions pas que les droits des femmes sont souvent les premiers attaqués quand l’autoritarisme gagne.
Alors, oui, en cas de victoire, ces violences ne manqueraient pas de choquer, d’énerver, voire de révolter. C’est pour cela que les régimes autoritaires comme la Chine ou la Russie fliquent tout le monde. Caméras de surveillance, espionnage, délation et surtout une police aux moyens disproportionnées. Au point de ne parfois plus attendre qu’un crime ait lieu pour le juger.
Minority Report a plus de 20 ans et un peu comme Tom Cruise, le film n’a pas vieilli. Sa police futuriste y utilise des jumeaux, soit-disant devins, pour prédire les crimes et les arrêter avant qu’il n’aient lieu. Le héros participe d’ailleurs à ce système jusqu’à ce qu’il en soit lui-même la cible arbitraire. L’apothéose d’une police toute puissante qui vous arrêtera chez vous, avant même que vous ne pensiez à désobéir. Ca vous semble fou ? Pourtant, en France, on interdit déjà des manifestations écolos et on arrête des soit-disant “écoterroristes” sans motif criminel. Blast en parlait encore récemment dans l’une de leurs vidéos.
Pas besoin de l’extrême-droite donc pour que les droits fondamentaux soient attaqués, les violence policières ou la vidéosurveillance normalisée. Mais ce qui est sûr, c’est que leur arrivée au pouvoir aggraverait le processus et la répression.
Et si les films américains ont l’optimisme hollywoodien de toujours voir la démocratie victorieuse, même dans la plus violente révolte, la réalité est souvent bien plus sombre.
Une fois installé, un régime autoritaire n’a aucun mal à s’enraciner. Il se normalise et met en place des routines, même dans l’oppression et les violences. Pour boucler notre vidéo, c’est un autre cours d’Histoire que celui du film la Vague, que nous donne La Zone d’intérêt, grand prix du jury à Cannes en 2023.
Le film de Jonathan Glazer, comme ses personnages, s’installe à côté d’Auchwitz, le plus grand camp de concentration nazi de la Seconde guerre mondiale. Le commandant en charge du camp et sa famille vivent dans la maison adossée au camp d’extermination.
« Nous avons passé un merveilleux séjour dans la maison Höss. Il restera parmi nos plus beaux souvenirs de vacances. A l’Est réside notre avenir. Merci pour cet accueil national-socialiste. » La zone d’intérêt, Jonathan Glazer (2023)
Aveugles aux horreurs du camp qui ne nous sera d’ailleurs jamais montré. Les nazis y vivent une vie de rêve : l’extermination des juifs n’est qu’un travail, les victimes n’existent qu’en fond sonore y compris pour le spectateur. Les horreurs du camp sont, pour les familles, presque aussi virtuelles que celles que nous scrollons, nous, sur notre téléphone tous les jours : à Gaza, en Ukraine ou en Iran.
La vie du plus grand nombre s’accommode très bien des régimes autoritaires ou d’extrême-droite. Beaucoup d’entre nous ne subirions sûrement pas les effets directs de ces politiques inégalitaires, violentes, répressives. Et c’est ce que montre La zone d’intérêt : cette facile banalisation du mal.
Ce que le cinéma historique de la seconde guerre mondiale mais aussi les œuvres plus inventives de Science-fiction interrogent, c’est cette capacité à accepter le pire et les difficultés que nous aurons à le combattre, une fois au pouvoir.
Alors, plutôt que d’attendre, que La vague passe, sans savoir combien de temps elle va durer, peut-être vaut-il mieux anticiper son arrivée. Parce qu’il n’y a que dans les films qu’on gagne à tous les coups.
–
Réalisation et montage : Elliot Clarke