Wild Legal : quand la nature reprend son droit – 06/05/25
Et si on donnait des droits à la Garonne, à la forêt des Landes, ou encore aux glaciers des Alpes ? Chaque année, on voit des forêts brûler, des glaciers disparaître, des fleuves de plus en plus pollués… Mais comment on protège concrètement ces milieux naturels précieux ? Qui pour s’en charger ? C’est au cœur de la réflexion du mouvement pour les droits de la nature.
Pour bien comprendre, nous avons échangé avec Marine Calmet, avocate de formation et juriste spécialisée en droit de la nature, présidente de l’ONG Wild Legal. Elle nous explique que repenser la place et les droits de la nature, ce n’est pas seulement un enjeu écologique, c’est, aussi, une question de démocratie.
L’ambition principale de ce mouvement s’enracine dans le fait que la nature ait des droits fondamentaux. L’idée serait de reconnaître une personnalité juridique à la nature et à tous les êtres vivants, même s’ils ne sont pas humains. Ce qui est loin d’être le cas aujourd’hui. En France, le droit de l’environnement attribue à la nature et au vivant un statut de ressource, de marchandise. Ils sont donc considérés au même titre que des objets. Donner des droits à la nature, ça permettrait d’interroger nos rapports à elle mais aussi sa place dans la société. Un questionnement qui devient urgent face à la crise écologique que nous traversons.
« Face à un modèle qui ne représente que les intérêts humains aujourd’hui, et surtout des intérêts économiques et court-termistes, il s’agit d’élargir notre focale politique aux autres qu’humains qui ont, eux aussi, des besoins propres, des intérêts particuliers. Il s’agit de faire en sorte de trouver dans ces leviers démocratiques et juridiques des réponses à la crise écologique qui nous touche aujourd’hui. » Marine Calmet, Wild Legal
Comme l’explique Marine Calmet, c’est aussi un combat pour une meilleure prise de décision collective, puisque les citoyens seraient au centre de cette nouvelle dynamique. Comme c’est déjà le cas aux États-Unis, pays pionnier de ce courant. C’est Christopher Stone qui l’a théorisé dans les années 70 même si, comme elle nous le raconte, ces combats ont mis plusieurs années à émerger sur la scène internationale. On en a un bel exemple en 2008 en Equateur où le gouvernement a inscrit les droits de la Nature dans leur Constitution. Une initiative nationale qui a permis aux citoyennes et citoyens d’agir, de saisir les tribunaux pour de grandes causes. Marine Calmet cite entre autres le combat contre la pêche intensive ou les permis miniers en forêt tropicale.
Un outil pour se battre localement
Des combats qui impactent également la gouvernance, les décisions collectives en incluant d’autres personnalités juridiques que les citoyens humains. En Nouvelle-Zélande, cela a permis une meilleure collaboration entre les peuples autochtones Maoris et l’État central par exemple. Notamment, sur la gestion du fleuve Wanganui. Les Néo-zélandais lui ont reconnu une personnalité juridique, des droits fondamentaux. Le fleuve est depuis « représenté » par deux gardiens : un nommé par l’Etat, l’autre par les peuple Maoris qui sont, nous dit Marine Calmet, le visage du fleuve. Et en Europe aussi, l’idée essaime.
« Ça s’est transposé dans de nombreux Etats ! L’Espagne a vraiment totalement repensée une gouvernance à l’échelle d’un écosystème : la Mar Menor, premier écosystème européen à être titulaire de droits fondamentaux. Il y a 3 comités, qui représentent les objectifs à atteindre pour protéger les droits fondamentaux de cette lagune. » Marine Calmet, Wild Legal
Des comités composés de citoyens, de scientifiques, d’associations ou d’entreprises avec des places et rôles différents dans la gestion de son fleuve et sa protection. Une démarche unique en Europe selon Marine Calmet qui y voit un modèle de démocratie locale écolo, « écosystémique ». Une démocratie qui se pense à partir de son milieu de vie et des attaques à son encontre.
Parce que, Marine Calmet insiste fortement là-dessus, ce combat pour les droits de la Nature est un combat de crise. Face à l’appropriation et à l’exploitation des multinationales, les citoyennes et citoyens n’ont d’autres choix que de se battre pour leur environnement. Un mouvement qu’elle qualifie de Résistance. Un combat par le Droit et pacifique. La proposition d’inventer une nouvelle place juridique pour que les habitants s’emparent de ces combats, un nouvel outil dans la Loi. Le tout pour faire émerger de nouveaux lieux de décisions collectives pour une « gouvernance écocentrée ».
L’être humain n’est pas hors sol
C’est pour accompagner cette progression, Marine Calmet a co-fondé l’ONG Wild Legal. Cette association a été créée pour porter le mouvement des droits de la nature en France, et l’adapter aux spécificités de notre société. L’idée, c’est de faire changer le système juridique sur la question, mais aussi d’accompagner un changement d’imaginaire. D’après la juriste, c’est une des solutions pour faire émerger des solutions concrètes, et donc une véritable transition écologique.
Pensée comme une école de juristes et un incubateur d’initiatives locales, l’association Wild Legal égraine ces idées et des expériences de mise en pratique : conventions citoyennes sur les droits des fleuves (on vous reparlera bientôt de celle sur la Seine), réécriture de documents de planification écologique, procès fictifs. A l’image de celui organisé avec la mairie de Paris au Théâtre de la Concorde récemment, initiant une convention citoyenne parisienne sur les droits de la Seine (on vous en reparle bientôt).
« Demain, l’habitabilité de nos territoires, c’est essentiellement une question de comment on relationne aux autres, comment on protège nos liens d’interdépendance. L’être humain n’est pas un être hors sol, il a besoin de tous les autres êtres vivants pour vivre. Et notre modèle démocratique n’est pas représentatif de la réalité de ces interdépendances. Et donc c’est un bouleversement, certes, mais en fait c’est absolument nécessaire. » Marine Calmet, Wild Legal
La juriste s’accorde à dire que la démarche est complexe mais nécessaire. D’autant que la progression de l’Histoire tient, selon elle, à cette complexification. Elle cite en exemple l’obtention du droit de vote par les femmes, ce moment où plus de la moitié de l’Humanité est entrée dans le système électoral. Faire entrer les autres qu’humains dans la démocratie permettrait de mieux analyser et prendre les décisions collectives, au regard de notre environnement et de celles et ceux, animaux, fleuves et forêts, qui le compose. Et, ce, pour protéger la Nature mais aussi les générations futures.
–
Réalisation et montage : Perrine Bontemps / Article : Elliot Clarke
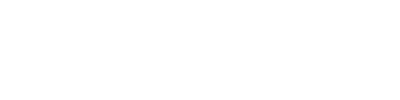
Ping :Les actus démocratiques du 07/06/2025 – MOB, le média de la démocratie