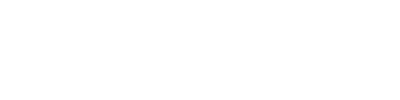Liberté d’expression, le choc des visions – 14/05/2025
Macron, Mélenchon, Bardella et même Trump, tout le monde défend la liberté d’expression. Pourtant, aujourd’hui, elle est menacée. On s’en rend bien compte si on se penche sur la liberté des journalistes, y compris chez nous. En 2024, la France était 21e dans le classement de la liberté de la presse de Reporter sans frontière. Un résultat pas très glorieux pour le pays des droits de l’homme, notamment à cause des violences que subissent les journalistes de la part des forces de l’ordre. Dans le monde, 75 % des pays sont considérés comme défavorables à la liberté d’information. Et si on s’en prend même à la liberté de la presse, c’est que la liberté d’expression est attaquée ailleurs.
Par exemple, on lit dans Libération qu’aux États-Unis, des universités perdent des subventions à cause de manifestations pro Palestine. La Chine traque ses opposants jusqu’en France pour les faire taire, comme l’a démontré l’enquête du Monde « China Targets ». Et en France, des militants écolo sont attaqués en justice. Bref, ça craint. Pouvoir s’exprimer librement est un des fondements de notre système démocratique. Mais aujourd’hui, c’est menacé notamment parce qu’on ne semble pas se mettre d’accord sur sa définition. Dans la loi, « la liberté d’expression octroie à tout individu le droit d’exprimer ses opinions sans risquer d’être sanctionné. » Et ce droit, fondamental pour la démocratie, intègre d’autres droits très importants : la liberté d’opinion, de la presse, de manifestation et le droit de grève.
On ne peut pas tout dire pour autant
La loi impose certaines limites, et c’est là que deux interprétations s’opposent et la fragilisent. D’un côté, il y a une vision de la liberté d’expression, plutôt européenne, où les institutions peuvent limiter la liberté. La diffamation, les atteintes à la vie privée et la discrimination sont interdites par la Cour européenne des droits de l’Homme. On pourrait appeler ça des « censures positives » qui suivent le principe de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen : « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui ». Ce qui explique, par exemple, la récente condamnation d’Eric Zemmour à payer 9 000€ d’amende pour injure raciale, relatée par Libération. La chaîne C8 a également été fermée par le « policier de l’audiovisuel », l’Arcom, en suivant ce principe. Une loi héritée de la Révolution française.
Mais si cette limitation est historique en France, les États-Unis en ont une vision complètement différente, et c’est cette définition qui se diffuse chez nous en ce moment. Là-bas, la liberté d’expression est beaucoup plus permissive. Si on se fie à leur 1er Amendement, on peut tout dire. Même des propos qui nous semblent dangereux, comme par exemple des théories du complot ou des fake news. Et c’est cette perception qui s’applique de plus en plus, en pratique, directement sur les réseaux sociaux. Les propriétaires des plateformes les plus populaires sont américains et suivent ce principe. Musk a racheté Twitter en prônant cette défense de la liberté d’expression par exemple.
Définition européenne VS américaine
Le problème, pour eux, c’est qu’ils sont confrontés aux réglementations européennes, comme le Digital Services Act qui régule les plateformes numériques. Son objectif est de “mieux protéger les internautes européens et leurs droits fondamentaux”. Mais ces contraintes légales ne plaisent pas, et X s’est débarrassé de tout ce qu’il pouvait. En mai 2023 il s’est retiré du Code européen de lutte contre la désinformation. Du coup, la plateforme abandonne le fact checking et lui préfère les notes de communauté. Pressa Media explique que les modérateurs humains professionnels et l’IA sont donc de moins en moins utilisés pour la modération. Bien sûr, faisons confiance aux Twittos.
Et c’est là que ça se complique. Jusqu’à maintenant, c’était la responsabilité des pouvoirs publics de l’encadrer. Mais désormais les acteurs privés s’y mettent et imposent leur définition et leurs usages, puisque les plateformes numériques leur appartiennent. X, Instagram, Facebook et TikTok sont les réseaux sociaux les plus utilisés dans le monde, et leurs propriétaires choisissent ce qui apparaît dans nos fils d’actualité.
En 2023, l’ONG Human Rights Watch a enquêté sur la « censure systémique » de Facebook et Instagram des contenus liés à la Palestine. En 2024, des influenceurs dénonçaient le shadowban sur Instagram lorsqu’ils partageaient leur soutien à la Palestine. Plus récemment, toute critique de Musk sur Twitter était synonyme de chute d’engagement drastique. Et ses tweets personnels sont mis en avant. Bref, ces soi-disant défenseurs de la liberté d’expression décident avec leurs algorithmes de ce qu’on voit. Alors même qu’ils ne sont pas neutres, bien au contraire.
Pour creuser sur le sujet, on avait discuté avec ChatGPT de l’impact des algorithmes et plus globalement de l’IA sur la démocratie.
Que ce soit l’État ou un réseau social, il y a toujours quelqu’un pour contrôler cette liberté d’expression. C’est pour ça que la définition américaine est dangereuse. Parce que derrière la phrase “on ne peut plus rien dire” se cache bien souvent le risque de laisser circuler des idées problématiques. Et ça, ça met en péril un autre principe démocratique : empêcher la diffamation, la discrimination ou l’incitation à la haine. Notre vision moins permissive de la liberté d’expression a le mérite de protéger les citoyens. D’autant plus que des vagues autoritaires émergent partout dans le monde. Alors, oui c’est important de pouvoir s’exprimer librement mais jamais au détriment des autres.
–
Réalisation et montage : Flavie Roussel / MOB