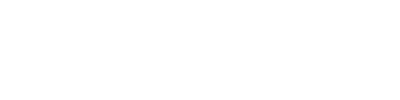Justice : l’indépendance en procès – 27/10/25
« Procès politique » « juges rouges, « justice partisane »… L’indépendance de la justice est attaquée de toute part, à la sortie même du procès de Sarkozy commente-t-on récemment chez Mediapart. Idem, il y a quelques mois, sur M6, quand Marine Le Pen écopait d’une peine d’inéligibilité dans l’affaire des assistants parlementaires européens. Pourtant, l’indépendance de la justice est un principe fondamental en démocratie.
Mais comment est-elle garantie ? Comment se traduit-elle dans le travail quotidien des magistrats ? Pourquoi est-elle attaquée régulièrement ces dernières années ? Autant de questions que nous avons posées à Stéphane Fischesser, magistrat et secrétaire national au syndicat de la magistrature.
On nous l’apprend brièvement à l’école, notre système républicain est découpé en trois grands pouvoirs : les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire. Pour que le tout fonctionne, il faut que les trois s’équilibrent. La justice est justement là pour s’assurer du respect des lois (pouvoir judiciaire). Des lois votées, elles, par les parlementaires élus par le peuple (le pouvoir législatif) avant d’être mises en application par le gouvernement (pouvoir exécutif).
L’indépendance de la justice existe notamment pour que son rôle puisse être exercé sans pression ou influence extérieure des deux autres centres du pouvoir politique. Pour la garantir, on a quelques piliers : la Constitution, texte le plus important du système juridique français, le président de la République ou la Convention européenne des droits de l’homme.
Y a pas de promotion qui tienne
Créé en juin 1968, le syndicat de la magistrature, plutôt classé à gauche, défend une justice pleinement indépendante. Stéphane Fischesser nous rassure, en tout cas, sur le travail actuel des magistrats. Il prend l’exemple des juges d’instruction qui manoeuvrent des enquêtes de police ou celui des juges des enfants qui ordonnent des placements. Leurs décisions sont personnelles, individuelles mais contraignantes. Les forces de police, les départements concernés ou l’aide sociale à l’enfance doivent les appliquer. Leur autorité judiciaire, le respect de ces décisions, est une première preuve d’indépendance selon le magistrat du syndicat. Mais, au-delà de cette autorité, c’est la possibilité de faire leur travail sans pression sur leur carrière qui garantie cette indépendance.
« Si un juge d’instruction, un procureur de la République enquête sur des infractions à la probité, de corruption, il faut qu’il puisse le faire sans que ça vienne les affecter personnellement. […] C’est le fait de se dire « il ne faut pas que je puisse rendre une décision en espérant derrière une promotion » ou au contraire en me disant « je risque de ne pas avoir le poste que je souhaite ensuite ». Stéphane Fischesser, représentant du syndicat de la magistrature
Cette sérénité est notamment garantie par le principe d’inamovibilité, le fait de ne pas pouvoir être réaffecté de manière arbitraire, sans leur consentement. Une règle seulement valable pour les juges.
Hiérarchie n’est pas dépendance, si ?
Parce qu »il y a deux catégories de magistrats. Ceux du siège, donc les juges, qui rendent les décisions de justice. Et il y a ceux du parquet, qui sont les procureurs de la république, chargés de mener les enquêtes et d’engager les poursuites. Chacun dépend d’une autorité différente : il s’agit du Conseil supérieur de la magistrature pour les juges et du ministre de la Justice pour les procureurs.
Ces derniers ne sont donc pas inamovibles. Ils sont sous la hiérarchie du garde des Sceaux parce qu’ils sont chargés d’appliquer la politique pénale définie par le Gouvernement. En gros, c’est le ministère de la Justice qui décide où mettre l’accent (par exemple sur le trafic de stupéfiants ou les violences conjugales), mais il ne ne peut pas donner d’instructions individuelles. Dans cette logique hiérarchique, c’est aussi lui qui décide des affections et des sanctions envers les procureurs. Il est quand même supervisé dans ces missions par le Conseil supérieur de la magistrature, garant d’une légitimité de ces décisions gouvernementales.
Stéphane Fischesser insiste donc fortement sur la grande indépendance dans son corps de métier. Il ne manque pas de souligner également que cette autonomie ne rime pas avec « toute-puissance ». Le pouvoir judiciaire a aussi ses devoirs et ses procédures de contrôle.
« Les magistrats sont de plus en plus obligés d’expliquer le raisonnement qui les a conduits à prendre leurs décisions. Par ailleurs, les magistrats doivent aussi accepter qu’ils peuvent se tromper. Ils sont des êtres humains comme tout le monde. Il y a une garantie fondamentale par rapport à ça, c’est le droit de faire appel. Quand ils commettent plus que des erreurs mais vraiment des fautes, il y a aussi la voie disciplinaire. » Stéphane Fischesser, représentant du syndicat de la magistrature
Aux vues de l’actualité, pour illustrer son propos, il pointe les avancées de la justice fiscale et économique de ces dernières années. La création du parquet national financier en 2013 en est une instance. Il permet de lutter contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière. Et c’est justement dans ce type d’affaires que les critiques envers la justice se font souvent entendre.
Un système perfectible mais à défendre
Ce fut le cas cette année, dans les affaires des assistants parlementaires européens du Rassemblement national impliquant Marine Le Pen, ou dans celle des financements libyens avec Nicolas Sarkozy. Ces affaires sont très complexes, comme le prouve le titre du documentaire de Yannick Kergoat sur l’affaire de Sarkozy : Personne n’y comprend rien. Et leur complexité érode, pour le grand public, leur nature criminelle. Une porte ouverte pour les mis-es en cause pour critiquer le travail de la Justice.
Des attaques directes à un des garde-fous de la démocratie. Même si, comme tout corps de métier, les magistrats sont critiquables, le système perfectible, s’attaquer aux contre-pouvoirs est souvent le signe de dérives autoritaires et pas qu’en France, rappelle Stéphane Fischesser..
« Quand des magistrats sont menacés dans leur intégrité physique, voire menacés de mort, c’est la justice tout entière qui est attaquée. Dans une démocratie, ce qui est en danger et ce pourquoi il faut se battre, c’est pour la vitalité des contre-pouvoirs. Quand on regarde la Hongrie, la Pologne, la Turquie, c’est toujours les mêmes institutions, les mêmes personnes qui sont ciblées : les ONG, les médias et, concernant l’Etat, la justice. » Stéphane Fischesser, représentant du syndicat de la magistrature
Toutes celles et ceux qui participent donc à critiquer les abus du pouvoir en place. Une musique qu’on entend de plus en plus en France, on en parlait encore récemment à propos des attaques envers le secteur associatif. Le planning familial en est un bon exemple. Mais la concentration des médias comme les critiques répétées à leur travail participent aussi de cet affaissement des piliers démocratiques. Défendre le travail de la Justice, des médias ou des assos, c’est préserver garde-fous et contre-pouvoirs et éviter que les « verdicts politiques » ne deviennent arbitraires.
–
Réalisation et montage : Perrine Bontemps