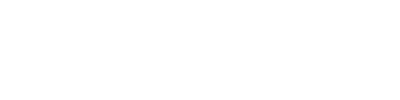Burn-out militant : prendre soin des luttes – 02/10/25
Écologie, féminisme, antiracisme, démocratie : ces luttes intenses sont énergivores et peuvent épuiser. Mais ce n’est pas une fatalité. Ces dernières années, le terme d’épuisement ou de burn-out militant a fait son entrée dans les espaces militants. Un moyen de souligner l’inégal rapport de force dans les luttes, le manque de moyens financiers, et donc humains, mais aussi de préserver les forces vives. Des solutions parfois très simples, à coup d’horizontalité et de démocratie dans ces combats.
C’est en 2019 qu’Anaïs Bourdet utilise le terme pour la première fois. La créatrice de la célèbre page Tumblr Paye ta shnek annonce alors la fermer pour cause de « burn-out militant ». Sur cette page, elle publiait des témoignages qui racontaient des situations de violences sexistes et sexuelles dans l’espace public. Elle passait son temps à les recueillir, à écouter les victimes. Et donc à recevoir des témoignages difficiles, tous les jours. Un recensement militant qui a fini par impacter sa santé mentale. Et qui est loin d’être un cas isolé. C’est pourquoi, à la suite de son message, plusieurs associations et collectifs féministes ont aussi pris la parole comme en témoigne l’article de Madmoizelle à l’époque.
Les causes de cet épuisement, psychique mais aussi physique, sont parfois liées aux causes que l’on porte : des sujets sensibles voire violents dans le cas des agressions sexuelles, des violences policières (dont on vous parlait récemment), intrafamiliales, racistes… Elles peuvent néanmoins, aussi, venir de l’organisation dans laquelle on milite.
L’image tenace du militant à toute épreuve
Les associations, collectifs, partis politiques sont souvent organisés de la même manière que les entreprises capitalistes, hiérarchiques, pyramidales, descendantes. C’est difficile de ne pas reproduire ce que l’on connaît, même quand on milite contre. Les conséquences de cette organisation sont alors similaires : l’épuisement des membres.
En cause notamment, une forte hiérarchie et peu d’écoute du collectif. La démocratie ne semble pas acquise dans l’organisation militante, malgré les valeurs portées par la plupart des structures. Et c’est là que ça pêche. Les activistes s’engagent souvent face à des dénis de démocratie venant de la sphère politique et sont animés par l’envie d’y remédier. Les illustrations sont nombreuses, rien que sur l’année passée : élections législatives, pétition contre la loi Duplomb et plus récemment le mouvement #BloquonsTout. Le problème arrive lorsqu’on se rend compte que les sujets de lutte se retrouvent aussi dans les organisations militantes. Comment alors ne pas baisser les bras ? L’engagement perd de son sens, et le militant de son énergie et de sa combativité. France Culture en a parlé avec de jeunes militants après les Législatives éclair de 2024.
D’autant qu’une image est tenace : celle du militant à tout épreuve, à base de culture du martyr et de don de soi. Une tradition d’engagement qui fait pas mal de dégâts. Elle profite aux organisations, pour supporter la surcharge de travail, la pression face au manque de temps et de reconnaissance, l’isolement parfois subi… En fait, par manque de moyens, aussi bien financiers qu’humains, les structures militantes s’appuient un peu trop sur leurs membres. Au risque de les lessiver.
Démocratie interne pour toustes !
Dans Burn-out militant, comment s’engager sans se cramer, Hélène Balazard (chercheuse en Sciences Politiques) et Simon Cottin-Marx (sociologue) suggèrent de voir l’activisme comme un travail, car il s’agit bien de cela, y compris quand on est bénévole. Même si le même but recherché et le fonctionnement sont différents, les risques psycho-sociaux sont les mêmes pour les salariés et les militants. Et comme dans le monde professionnel, il faut savoir couper et prendre du temps pour soi. C’est la seule solution pour recharger nos batteries nous disent les auteur-ices.
Les problèmes de financements sont évidemment aussi centraux dans l’épuisement militant mais sont systémiques et difficiles à résoudre dans les structures. On ne s’arrêtera donc pas trop là-dessus dans cet article. Par contre, l’organisation d’équipe, la gouvernance peuvent être plus facilement équilibrées et résolues à base de démocratie interne.
Dans Burn-out militant, les deux chercheurs développent des points de vigilance et des pistes de solutions afin d’éviter l’épuisement. Parmi ces points, celui de veiller à ce que les organisations ne créent pas de dominations. Pour cela, ils conseillent de veiller à ce que tout le monde puisse exprimer ses idées et opinions mais aussi que les rôles tournent pour limiter les rapports de pouvoir.
Prendre soin des luttes
D’autres suggestions ont attiré notre attention : mettre en place des cellules de soutien, notamment psychologique, au sein des collectifs, bien se préparer avant tout passage à l’action : aussi bien financièrement, juridiquement que face au cyberharcèlement par exemple. Il ne faut pas, non plus, oublier de fêter les petites victoires. Pour tenir sur la durée, quand on vise grand, il faut se réjouir de chaque avancée !
Les idées ne manquent pas, et de plus en plus de ressources sont accessibles en ligne, comme sur le site d’Amnesty International ou celui de Paye ton burnout militant.
Et, attention, militer n’amène pas forcément au burn-out, c’est avant tout une magnifique manière de mettre du sens dans sa vie et de s’engager pour le collectif. Mais c’est important d’avoir conscience de ses limites et de faire son possible pour se préserver de la fatigue associée. Et puis, protéger sa santé mentale, c’est aussi protéger les combats qu’on mène.
–
Article, réalisation et montage : Perrine Bontemps
Photo © Elliot Clarke pour Amnesty International France